Ingé son en live et en studio : peut-on faire les deux ?
Nous comparons les flux de travail des environnements de son live et de studio d'enregistrement.
Plongeons dans l’univers du live et celui du studio du point de vue de l’ingénieur du son, pour mieux comprendre ce qui rapproche et ce qui distingue ces deux mondes.
Sommaire
Aujourd’hui, la majorité des traitements audio, que ce soit sur scène ou en studio, passent par des plug-ins. Résultat : le rôle de l’ingénieur du son a évolué et on retrouve bien plus de similarités entre ces deux mondes qu’auparavant.
Sonorisation live et enregistrement studio
Mais est-ce que ça veut dire qu’un ingé son de studio peut facilement faire carrière dans le monde du spectacle ? Pour y répondre, il faut regarder de plus près les aspects communs aux deux pratiques, mais aussi ce qui fait leur spécificité.
Objectifs différents, approches différentes
Ce qu’il faut d’abord bien comprendre, c’est que les objectifs ne sont pas les mêmes. Lors d’un concert, ta mission principale en tant qu’ingé son, c’est de faire en sorte que le son soit correctement amplifié dans la salle. Ça implique de gérer le système de diffusion, tous les signaux qui transitent par la console, et surtout de veiller à ce que les musiciens sur scène puissent bien s’entendre jouer.

En studio, l’objectif est tout autre. Tu travailles dans un environnement acoustiquement maîtrisé, afin de capturer, mixer ou masteriser des morceaux. Il ne s’agit pas d’animer une foule, mais de créer un rendu sonore abouti pour un projet artistique, un disque, une bande-son… Le matériel utilisé varie aussi, bien sûr. Que ce soit les micros, les consoles, les moniteurs ou même le câblage, les exigences ne sont pas les mêmes. Si la fidélité et la clarté du son restent centrales, chaque contexte demande des compétences bien spécifiques.
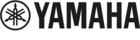

Le monitoring
Même si en studio on ne diffuse pas vers un public comme en live, il y a tout de même des points communs dans la manière dont on aborde le retour (monitoring), que ce soit dans une cabine d’enregistrement ou sur scène. Dans les deux cas, les musiciens ont besoin de pouvoir se repérer, de s’entendre correctement, et d’obtenir un équilibre individuel par rapport aux autres instruments.

En studio, on privilégie les casques fermés pour isoler au maximum chaque prise. Sur scène, on utilise plutôt des systèmes de monitoring sans fil, qui laissent une plus grande liberté de mouvement et protègent mieux des nuisances extérieures. Certains artistes utilisent aussi des retours de scène inclinés pour éviter les effets de larsen.
En tant qu’ingénieur du son, la démarche de monitoring reste assez proche : tu travailles avec des moniteurs ou des casques dans les deux cas. Mais en live, avec une sonorisation puissante, tu peux déléguer à un assistant la vérification des niveaux, directement depuis différentes zones de la salle. À l’inverse, en studio, tu es dans un espace traité acoustiquement, ce qui offre davantage de liberté dans le choix des enceintes de monitoring.
Les micros
Côté micros, il y a des passerelles. Certains artistes comme Bono de U2 préfèrent utiliser le même micro (Shure Beta 58), que ce soit sur scène ou en studio. Mais sur scène, le risque de larsen est bien plus élevé, donc il faut limiter au maximum les fuites et les débordements de son.

En concert, un micro sert surtout à amplifier et projeter les sons pour qu’ils soient entendus clairement, peu importe où se trouve le public. En studio, l’enjeu est plus subtil : on cherche à capturer une ambiance, une texture, à créer une image sonore fidèle et expressive. Du coup, on utilise souvent des micros plus sensibles, adaptés à ce type de travail minutieux.
Les micros utilisés en live sont généralement dynamiques ou à condensateur hypercardioïdes, précisément choisis pour limiter les sons hors axe. Ils sont aussi placés au plus près de la source sonore pour garantir un signal net et sans pollution. En studio, en revanche, la palette est quasiment infinie, avec la possibilité d’explorer beaucoup plus de configurations selon le style de musique et la sensibilité recherchée.
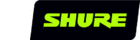

Le mixage
Dans les deux univers, on retrouve pas mal d’outils communs pour mixer : plug-ins, racks externes, chaînes de traitement vocal, bus de batterie… tout ça peut être utilisé aussi bien en studio qu’en live. Ça permet d’ailleurs à beaucoup d’ingés son de passer d’un monde à l’autre, à condition de bien intégrer certaines bases.

Le mix en live demande généralement de la réactivité et une bonne résistance au stress. Chaque décision a un impact immédiat, tu n’as pas le droit à l’erreur. Heureusement, quand tu tournes avec un groupe, tu peux anticiper en mémorisant des presets pour chaque morceau de la setlist. En studio, l’approche est plus lente, plus analytique. Tu prends le temps de sculpter chaque son, en pensant à sa restitution sur différents systèmes d’écoute.
L’expérimentation est aussi plus facile en studio. Sur scène, tu vas souvent filtrer de manière plus radicale les basses avec des coupe-bas, parce que ton écoute se fait souvent au casque et que les problèmes de fréquences peuvent vite devenir gênants. En studio, un client peut te demander une ambiance différente pour chaque titre de son album, tandis qu’en tournée ton objectif reste d’assurer une expérience sonore homogène à chaque concert, peu importe la salle.
Acheminement du signal
L’acheminement du signal ne fonctionne pas de la même manière sur scène ou en studio. En studio, tout est assez simple : on capte les sons dans la salle de prise, et on les envoie vers la régie, de l’autre côté de la vitre.

En live, c’est une autre histoire. Les signaux parcourent souvent de longues distances, en numérique, du boîtier de scène jusqu’à la console, puis au système de diffusion, souvent placé à proximité de la scène. Pour ça, on utilise des câbles Ethernet (CAT), et des convertisseurs analogiques/numériques supplémentaires pour faire le lien entre le matos analogique et la console numérique.
En studio, les prises sont souvent superposées les unes aux autres, mais il arrive qu’on ait besoin de créer des mixs de retour très personnalisés pour chaque musicien, surtout s’il s’agit d’un ensemble ou d’un groupe. En tournée, c’est plus simple : les mixs de retour peuvent être rappelés d’un simple bouton, avec les niveaux mémorisés pour chaque interprète, de sorte que tout soit prêt en quelques secondes.
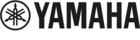

En savoir plus sur le son en live et l’enregistrement en studio :
- Guide Thomann des tables de mixage numériques
- Guide Thomann de l’enregistrement à domicile
- Les alternatives au micro live SM58
- Les micros sans fil pour la scène
*Remarque : cet article contient des liens d’affiliation qui nous aident à financer notre site. Pas d’inquiétude : le prix reste toujours le même pour toi ! Si tu achètes quelque chose par le biais de ces liens, nous recevrons une petite commission. Merci pour ton soutien.


